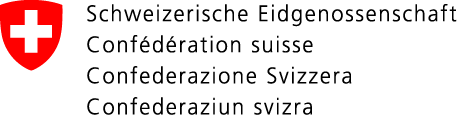Histoire de l'encouragement fédéral de la culture
Les débuts de l'encouragement fédéral de la culture
Jusqu'au début des années 70, l'idée prédominante en Suisse était que la culture appartenait au domaine privé. Les communes, les cantons et la Confédération soutenaient bien la création culturelle, mais la légitimité de ce soutien, les objectifs et les mesures nécessaires, n'étaient pas un thème de débat dans le domaine public. La compétence de la Confédération en matière de culture n'était pas inscrite telle quelle dans la Constitution mais découlait de l'esprit général de la Constitution et de ses grands principes fondateurs. Les activités culturelles de la Confédération à l'étranger et les échanges culturels internationaux étaient constitutionnellement légitimés dans les compétences de base de la Confédération en matière de politique extérieure.
Traditionnellement l'encouragement fédéral de la culture se limitait à une série de tâches sans relations bien définies entre elles : en 1848, la Confédération avait créé les Archives fédérales, puis le Musée national en 1890, et la Bibliothèque nationale en 1894. L'arrêté de 1886 sur les monuments historiques et celui de 1887 concernant l'avancement et l'encouragement des arts en Suisse furent les premiers textes de loi habilitant la Confédération à prendre des mesures d'encouragement dans le domaine culturel. Dans son Message du 9 décembre 1938 portant sur le maintien et la promotion des valeurs culturelles suisses, le Conseil fédéral plaçait la notion de « défense spirituelle » au centre des mesures de politique culturelle de la Confédération. Avec la communauté de travail Pro Helvetia, un organe indépendant de l'État fut créé dans le but de renforcer au plan culturel les « valeurs propres à la Suisse ».
1975 : Parution du rapport Clottu
A la fin des années 50 et au début des années 60, les lois sur la culture étaient motivées par le désir de préserver les biens culturels hérités du passé. La création contemporaine n'était que ponctuellement encouragée. Cette conception changea au début des années 70, lorsque l'on commença de privilégier davantage les interconnexions au niveau de la politique fédérale. Le rapport intitulé « Eléments pour une politique culturelle en Suisse », plus connu sous le nom de Rapport Clottu (1975), est le premier document qui engage une réflexion ambitieuse sur le rôle des pouvoirs publics dans le domaine de la culture.
Ce rapport documenté et éclairant reste à ce jour le seul inventaire sur la situation de la culture en Suisse. La notion de démocratie culturelle qui sous-tend la réflexion de la commission Clottu trouve notamment son expression dans la reprise de la définition large du fait culturel donnée par l'UNESCO et par le Conseil de l'Europe. Parmi les recommandations les plus importantes du rapport Clottu, on trouve, outre la création d'académies d'art nationales ou d'un centre national suisse de documentation et d'études en matière culturelle, l'idée d'un article culturel dans la Constitution octroyant à l'État les compétences nécessaires à un engagement politique plus fort en matière de culture.
L'initiative du pour-cent culturel
En 1980, l'initiative fédérale « en faveur de la culture » ravive le débat à propos de la politique culturelle. Si de larges milieux approuvent sur le fond les intentions des auteurs de l'initiative, la majorité des organismes qui s'expriment lors de la consultation rejette leur projet de réserver à des objectifs culturels un pour-cent des dépenses fédérales. D'autres voix s'élèvent pour demander qu'on attende la révision totale de la Constitution fédérale pour ouvrir la discussion concernant un article sur la culture. Plusieurs partis et organisations économiques, mais surtout les cantons, reprochent à l'initiative d'être trop centraliste et d'ignorer les prérogatives des cantons en matière de promotion de la culture. Ces objections et certaines autres réserves poussent le Conseil fédéral à élaborer un contre-projet - tout en reconnaissant la nécessité d'un article sur la culture.
Ce contre-projet évitait toutes les formules à résonance centraliste et s'abstenait de quantifier précisément les dépenses à prévoir. Il proposait cependant de donner un ancrage légal à la compétence de la Confédération en matière d'encouragement de la culture. Le message aux chambres fédérales comprenait déjà une esquisse détaillée de programme de politique culturelle : promotion de la création contemporaine dans la littérature, la musique, la danse, le théâtre, etc., subvention à la formation des adultes et à l'animation socio-culturelle, création d'incitations fiscales au mécénat privé, appui à la formation des acteurs culturels et au développement de leur protection sociale, meilleure protection des droits d'auteur, mise en place d'un centre d'information et de documentation, révision totale de la loi sur le cinéma, appui renforcé aux minorités linguistiques et culturelles, soutien aux activités de jeunesse extra-scolaires. En 1984, l'initiative du pour-cent culturel, soutenue par les partis de gauche, et le contre-projet du Conseil fédéral, favorisé par les partis bourgeois, sont tous deux rejetés par le peuple : la votation, qui ne mobilise que 35 % des électeurs, se solde par 16,7 % des voix en faveur de l'initiative et 39,3 % en faveur du contre-projet. L'analyse du scrutin montre que l'interdiction du double oui, en vigueur jusqu'en 1987, a alors été la cause du rejet de toute forme d'article sur la culture.
L'article sur l'encouragement de la culture
En 1991, le Conseil fédéral a soumis au Parlement un nouveau projet d'article constitutionnel sur la culture. Ce texte tenait compte du principe de subsidiarité et continuait d'affirmer le primat de la compétence des cantons en matière de culture, tout en accordant à la Confédération certaines compétences dans le domaine de la promotion de la vie culturelle en Suisse et des échanges culturels avec l'étranger. Le message concernant l'introduction dans la Constitution fédérale d'un article sur l'encouragement de la culture (art. 27septies a Cst) soulignait notamment la fonction de la culture dans la formation de notre identité, que ce soit à l'intérieur du pays ou au niveau international et qu'il s'agisse d'une identité locale, régionale ou nationale. Le Conseil fédéral insistait sur l'importance de la culture et de son encouragement, en soulignant le fait qu'elle est un facteur d'union, dans un pays qui compte quatre groupes linguistiques et plusieurs communautés culturelles.
Telles étaient les convictions du Conseil fédéral. Mais, parallèlement, les interrogations à propos de la compétence culturelle que le droit non-écrit reconnaissait à la Confédération allaient croissant. On ne remettait pas en question cette compétence elle-même, mais on objectait que reconnaître à la Confédération une compétence culturelle de façon tacite, ou par le biais d'un droit coutumier, n'était pas compatible avec le partage des compétences explicitement prévu par la Constitution (art. 3 a Cst). L'article sur l'encouragement de la culture visait à clarifier le droit constitutionnel en la matière, qui, par manque d'intelligibilité et de cohérence, était parfois peu satisfaisant sur le fond, en réglementant la promotion culturelle de la Confédération par des dispositions explicites et complètes. Le message de 1991 concernant l'article sur l'encouragement de la culture reprenait des propositions du message de 1984. Ainsi, le Conseil fédéral entendait permettre l'encouragement des domaines qui n'avaient jusqu'alors, en l'absence d'une base constitutionnelle, été soutenus que ponctuellement, la musique, la danse, le théâtre et la littérature, et créer dans ce but les services adéquats au sein de l'Office fédéral de la culture et les commissions consultatives correspondantes. En outre, il voulait instaurer une coordination systématique de la protection des biens culturels et de la promotion des manifestations culturelles, et créer un centre national d'information. Quant à la formation des acteurs culturels, ce n'était pas par le biais de la création d'écoles nationales - comme l'avait proposé le Rapport Clottu - qu'on se proposait de l'encourager, mais par un soutien apporté à la formation offerte aux niveaux cantonal et régional. D'autres propositions concernaient la mise en place d'un système minimal de protection sociale en faveur des acteurs culturels, des allègements fiscaux en faveur des mécènes privés et la réorganisation des médias électroniques. Dans le champ de la politique culturelle internationale, le message insistait sur les échanges et sur l'établissement de contacts entre les artistes du pays et de l'étranger. Le Conseil fédéral ne pensait pas que l'application de l'article sur l'encouragement de la culture devrait être assurée par une loi-cadre unique, mais plutôt par la publication ponctuelle de nouvelles lois et par des révisions législatives. À l'étonnement de nombreux observateurs, l'article sur l'encouragement de la culture ne passa pas le cap de la votation de 1994 : malgré un taux d'acceptation de quelque 51 %, le projet ne parvint pas à obtenir la majorité des cantons.
L'article sur la culture dans la nouvelle Constitution fédérale de l'an 2000
Ce n'est qu'avec la révision totale de la Constitution fédérale de 1999 que les activités d'encouragement de la culture de la Confédération reçoivent une base constitutionnelle. Dès lors, les cantons conservent fondamentalement leur compétence en matière culturelle (art. 69 al. I Cst). Par ailleurs, la nouvelle Constitution confirme les compétences jusqu'alors octroyées à la Confédération dans les domaines du cinéma (art. 71), de la protection du patrimoine culturel et des monuments (art. 78), de la politique des langues et de la compréhension (art. 70) et des relations culturelles avec l'étranger (art. 54), mais elle lui reconnaît aussi une compétence générale dans la promotion des activités culturelles présentant un intérêt national et dans le soutien aux arts, en particulier dans le domaine de la formation (art. 69 al. 2). De plus, la nouvelle Constitution introduit aussi un certain nombre d'innovations dans des domaines associés à la culture : la Confédération est habilitée à apporter son soutien à la formation des adultes, en appui aux mesures cantonales (art. 67 al. 2), à édicter des dispositions légales dans les secteurs de la formation culturelle de base et de la formation continue et à créer, gérer ou soutenir des hautes écoles et d'autres établissements d'enseignement supérieur (art. 63 al. 2). Outre les dispositions de l'article sur la culture (art. 69), la garantie de la liberté de l'art (art. 21) a une grande importance pour la définition du rapport entre l'État et la culture. L'article 35 charge la Confédération de veiller à ce que la population puisse exercer ses droits fondamentaux constitutionnellement reconnus.
Les termes de l'article 69 Cst sont les suivants:
1 La culture est du ressort des cantons.
2 La Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national et encourager l'expression artistique et musicale, en particulier par la promotion de la formation.
3 Dans l'accomplissement de ses tâches, elle tient compte de la diversité culturelle et linguistique du pays.
Loi sur l'encouragement de la culture (LEC)
Il s'agissait de concrétiser par une loi fédérale l'article 69 de la Constitution, le fameux « article culture ». L'Office fédéral de la culture fut chargé de la responsabilité du projet. La révision de la loi sur la fondation Pro Helvetia du 17 décembre 1965 eut lieu en parallèle. En 2005, le Conseil fédéral autorisait le Département fédéral de l'intérieur à mettre les deux lois en consultation. Quatre ans plus tard, le 11 décembre 2009, la LEC, à laquelle avaient été intégrés les articles concernant Pro Helvetia, était adoptée par le Parlement. La LEC est entrée en vigueur au 1er janvier 2012.